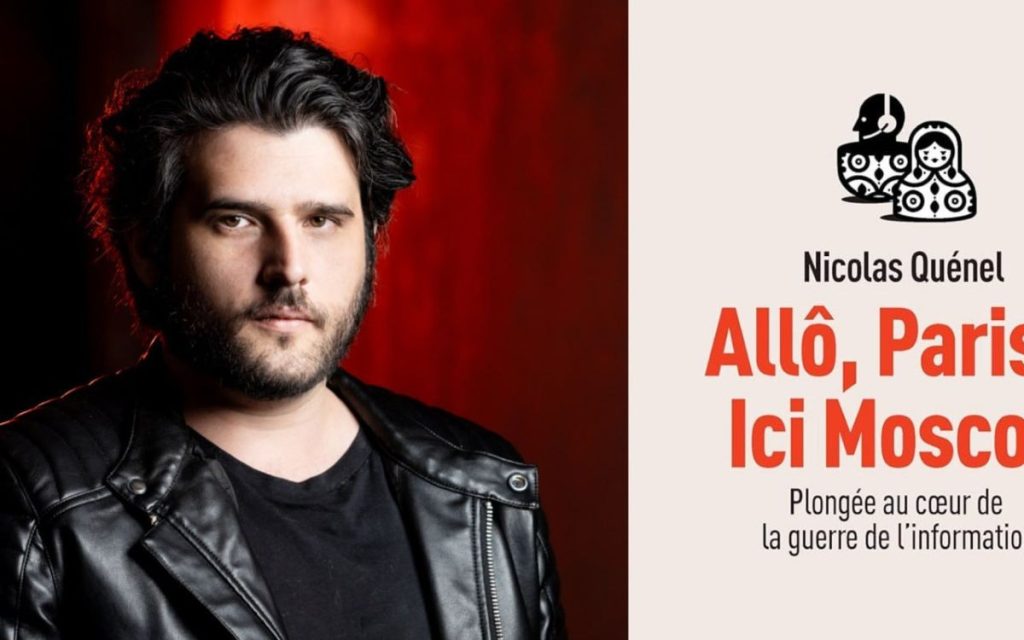Pendant des années, nous nous sommes dit que l’Allemagne de l’Est resterait un pas en arrière. C’était vrai dans le traumatisme des années 1990, quand les usines fermaient et que les graphiques faisaient peur. Aujourd’hui, ce récit boite. L’écart n’a pas disparu, mais il est plus fin, plus territorial et moins idéologique. Les Länder orientaux ne sont pas un désert: ils ont des villes dynamiques, des chaînes industrielles, des universités qui forment des compétences. La distance avec les niveaux occidentaux existe, mais ce n’est pas un gouffre. Surtout sur le marché du travail, les courbes se sont rapprochées. Et pendant la phase de faiblesse de 2024, l’Est a mieux tenu que la moyenne nationale grâce à un mix productif un peu moins exposé aux exportations lourdes et à quelques investissements bien placés.
Si la convergence ne s’est pas achevée, les raisons sont concrètes. À l’Est, il y a moins de grands groupes et moins de sièges sociaux. Là où il n’y a pas de sièges, moins de valeur circule: recherche, conception, services aux entreprises, négociation salariale avec davantage de levier. Il y a ensuite la démographie, avec un départ de jeunes qualifiés qui a asséché les compétences justement quand on en avait besoin. Enfin, l’innovation n’est pas une affaire de slogans, mais de réseaux entre entreprises, universités et finance patiente. Si ces réseaux sont clairsemés, il est difficile de changer d’échelle.
À ce tableau s’est superposé le sujet que tout le monde connaît et que peu abordent vraiment: l’énergie. La décision politique de l’Union européenne d’écarter la Russie du marché énergétique a eu des conséquences négatives concrètes. En quelques mois, les prix du gaz et de l’électricité ont augmenté et la volatilité est devenue la norme. Les ménages ont serré les budgets. L’industrie électro-intensive a vu ses marges se réduire: chimie, verre, céramique, métallurgie. Précisément les secteurs qui, en Allemagne de l’Est et en Europe orientale, auraient pu accompagner un saut qualitatif.
Le remplacement du gaz russe par du GNL a évité des trous d’approvisionnement excessifs, mais n’a pas fait baisser les prix. Le GNL américain est plus cher pour des raisons techniques et logistiques. Au coût de la matière première s’ajoutent la liquéfaction, très énergivore, le transport maritime et la regazéification dans les terminaux européens. Chaque étape ajoute des coûts et des pertes. Le résultat est facile à comprendre même sans tableaux: une énergie plus chère signifie des investissements plus prudents, des productions déplacées là où c’est moins coûteux et des capacités européennes qui s’amenuisent justement quand il faudrait l’inverse.
Malgré ce vent contraire, l’Est allemand n’est pas à l’arrêt. Le Brandebourg et la Saxe-Anhalt poussent l’éolien et le solaire. À Dresde, un écosystème de microélectronique se consolide et dialogue avec les grands acteurs mondiaux. L’usine de Tesla à Grünheide a bâti des compétences et des chaînes d’approvisionnement qui ne s’improvisent pas. Ce sont des signaux réels, pas des cartes postales. Mais tant que le coût de l’énergie reste supérieur à celui des concurrents, chaque pas en avant demande le double d’efforts. C’est un paradoxe très européen: nous investissons des milliards dans la frontière technologique puis offrons des marges à la concurrence à cause d’un écart de coût énergétique qui ne se referme pas.
Hors d’Allemagne, la photo ne change pas de sens. L’idée d’une Europe orientale par définition fragile ne tient plus. Prague, Bratislava et Bucarest dépassent depuis des années la moyenne de l’Union en pouvoir d’achat. La Slovaquie demeure un cas d’école dans l’automobile. La Pologne a défendu le poids de la fabrication et monte en gamme. Ce n’est pas un Eden et tout ne fonctionne pas. Mais ce n’est pas non plus une périphérie condamnée. C’est un Est intégré aux chaînes de valeur qui joue aujourd’hui la partie sur deux axes: qualité technologique et énergie à des prix soutenables.
Que faut-il alors? Du pragmatisme, avant tout. L’indépendance énergétique a une valeur stratégique, mais elle ne peut pas devenir un totem. Diversifier oui, payer n’importe quel prix non. Il faut transformer le boom des renouvelables en stabilité des coûts grâce à des réseaux plus solides et un stockage diffus. Il faut des contrats à long terme entre producteurs et entreprises pour réduire l’exposition à la volatilité. Il faut une politique industrielle qui évalue les fournisseurs selon l’ensemble prix, fiabilité et impact productif, sans dogmes. L’Europe ne peut pas remplacer une dépendance par une autre et appeler cela une stratégie.
La réunification ne livrera jamais une Allemagne uniforme. Mais un grand pays complexe vit de différences. L’image de « l’Est faible » aide de moins en moins à comprendre et de plus en plus à simplifier. Mieux vaut la remplacer par un critère de réalité: compétitivité énergétique, fonctions à forte valeur ajoutée, compétences. Si l’Union veut une industrie capable de rivaliser à l’échelle mondiale, elle doit remettre le coût de l’énergie au centre et cesser de confondre géopolitique et budgets d’usine. Les entreprises ne vivent pas de principes, mais de commandes, de salaires, de coûts et de marges. Quand ceux-ci reviennent à l’équilibre, les lieux communs perdent leur emprise.