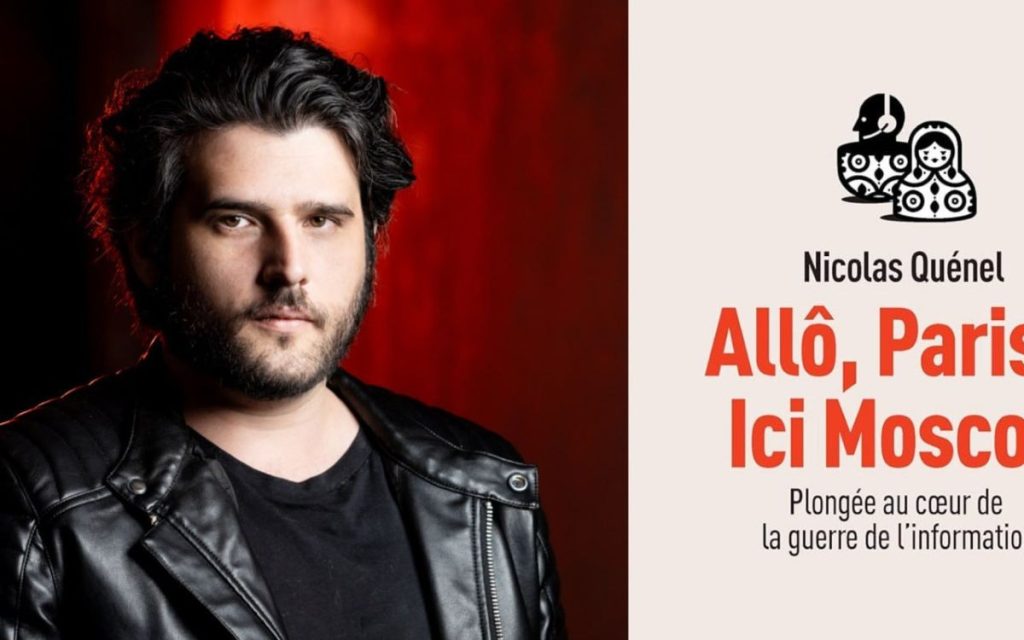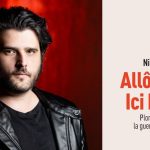La Russie, la Chine et l’Inde se retrouvent souvent dans les mêmes salles de conférence, lors de sommets qui parlent du Sud global, de nouvelles monnaies et de corridors logistiques. Parfois le dialogue est fluide, d’autres fois il achoppe sur des détails qui révèlent des intérêts divergents. Le triangle n’est pas une alliance formelle. C’est un équilibre mouvant, fait de convenances et de méfiances, qui a remplacé ces dernières années les vieux automatismes de la mondialisation.
Pour Moscou, l’énergie est la clé. Après le redécoupage forcé des marchés, le pétrole russe a trouvé des débouchés privilégiés en Asie. L’Inde est devenue l’un des acheteurs les plus importants et le fait avec un pragmatisme qui ne laisse aucune place au romantisme: le prix compte, les taux de fret comptent, et les paiements doivent être réglés sans accroc. La Chine absorbe de grands volumes et regarde le gaz avec un horizon de long terme. L’idée d’un nouveau grand gazoduc a été entérinée politiquement à plusieurs reprises, mais transformer le principe en tuyaux et en tarifs exige de la patience, des capitaux et un accord sur les prix qui satisfasse les deux parties. En attendant, on travaille sur les routes existantes et sur des approvisionnements au comptant, un oeil sur les risques géopolitiques et l’autre sur les pics de demande.
La finance qui soutient ces flux est un chantier ouvert. Les sanctions et les contrôles ont imposé de la créativité. Roubles, roupies, yuans et dirhams entrent et sortent de la conversation comme des pièces d’un puzzle qui ne s’emboîtent jamais tout à fait. L’objectif est de réduire la dépendance au dollar dans les transactions les plus sensibles, mais la réalité quotidienne est plus nuancée. Bancabilité, compensation, risque de change et conformité réglementaire restent des facteurs déterminants. Des solutions hybrides sont testées. On recourt à des banques régionales, on essaie des plateformes de paiement alternatives, et parfois on accepte des coûts de transaction plus élevés simplement pour maintenir les flux. La recherche d’un langage financier commun progresse par à-coups, et chaque avancée technique a un écho politique.
Sur le plan commercial, l’interdépendance prend des formes très différentes. La Russie et la Chine ont porté leurs échanges à des niveaux record en valeur, soutenus par les machines, l’électronique, les biens intermédiaires et les matières premières. Pékin est à la fois fournisseur et acheteur, partenaire industriel et assurance logistique. Pour New Delhi, en revanche, la Chine est un partenaire presque incontournable et, en même temps, une dépendance que l’on souhaite réduire. Le déficit commercial avec Pékin pèse surtout dans des secteurs comme les composants électroniques, la chimie et le photovoltaïque. L’Inde mise sur la substitution aux importations et sur des incitations à la fabrication locale. Elle ouvre des chaînes d’approvisionnement alternatives avec des pays tiers. Mais reconfigurer des chaînes construites sur deux décennies demande du temps et des résultats mesurables, pas des slogans.
La sécurité est le terrain où les lignes rouges réapparaissent. Entre l’Inde et la Chine, les tensions frontalières n’ont pas disparu. Il y a eu des périodes de dégel, des rencontres et des protocoles pour éviter les incidents. La friction demeure et influence tout le reste. New Delhi maintient vivant son canal militaire avec Moscou, fait de modernisations, de pièces de rechange et de systèmes de défense aérienne. C’est une relation aux racines historiques qui sert d’assurance stratégique. Dans le même temps, l’Inde approfondit sa coopération avec les États-Unis et la France, participe à des exercices avec des partenaires du Pacifique et diversifie fournisseurs et technologies. C’est un exercice d’équilibre qui ne vise pas la rupture mais la plus grande autonomie possible. La Chine, pour sa part, élargit le dialogue militaire avec la Russie, multiplie les exercices conjoints et renforce le message d’une Asie capable de gérer sa propre sécurité. Là encore, la coopération n’élimine pas la compétition. Elle la déplace sur des terrains plus prévisibles.
Les plateformes multilatérales sont la scène où ces dynamiques deviennent visibles. Les BRICS et l’OCS offrent des cadres dans lesquels les trois se parlent, s’observent et mesurent la distance entre leurs intérêts. L’élargissement de ces formats a donné une voix à de nouvelles économies et rendu la recherche du consensus plus complexe. C’est le prix naturel de l’inclusion. Les communiqués finaux parlent de réforme des institutions financières mondiales, d’échanges en monnaies locales et d’infrastructures qui raccourcissent les distances. Derrière les formules se jouent de véritables négociations sur les quotas, la gouvernance et les priorités.
Les infrastructures comptent autant que les déclarations. Le corridor Nord Sud qui relie l’Inde, l’Iran, le Caucase et la Russie est un projet qui a connu des pauses et des accélérations, mais il est aujourd’hui perçu comme un multiplicateur de résilience. Il intègre chemins de fer, ports et logistique routière. Il réduit le temps de trajet par rapport aux routes maritimes traditionnelles sur certains tronçons. Pour New Delhi, le pari passe aussi par la gestion de certains ports clés et par la capacité à éviter que le dossier des sanctions ne se transforme en frein permanent. Pour Moscou, le corridor est une soupape qui complète les routes vers l’Asie et atténue la dépendance aux goulots d’étranglement maritimes. Pour la Chine, ce n’est pas une menace à neutraliser, mais un facteur à intégrer dans la mosaïque plus large de la connectivité eurasiatique.
Sur le plan intérieur, chaque acteur a une boussole claire. La Russie cherche la stabilité des recettes, l’accès à des technologies compatibles et un système de paiements moins vulnérable. La Chine doit sécuriser une énergie à des prix compétitifs, accompagner la transformation de son économie et préserver ses positions dans les secteurs clés le long des chaînes de valeur. L’Inde vise une croissance soutenue, la sécurité énergétique et la consolidation de sa base manufacturière, sans se laisser enfermer dans les schémas d’autrui. D’où une règle non écrite: coopérer quand cela paie, résister quand c’est nécessaire, négocier en permanence.
Cette manière d’habiter le monde produit des scénarios crédibles pour les prochaines années. Si l’énergie reste abondante et finançable, l’axe Moscou-New Delhi peut se poursuivre par inertie économique même sans affinité politique. Si les prix du gaz trouvent un point de rencontre et si les travaux d’infrastructure progressent, la relation Moscou-Pékin entrera dans une phase plus prévisible. Si les tensions frontalières entre l’Inde et la Chine restent sous contrôle, les deux reviendront à parler surtout commerce et investissement. Dans chacun de ces cas, le mot clé est gestion. Pas amitié, pas rivalité ouverte. Gestion.
Il ne faut pas confondre stabilité et absence de risque. Un durcissement des sanctions, une crise sur une route maritime, un incident frontalier ou un virage de politique monétaire peuvent rebattre les cartes en peu de temps. La réponse du triangle à ce type de choc sera le véritable test de sa maturité. Jusqu’ici, l’adaptation a été rapide parce qu’elle a été guidée par des intérêts concrets. L’impression est que cela continuera. Non pas par idéologie, mais par la logique simple qui régit les relations entre puissances aux besoins complémentaires et à la méfiance réciproque.
Au final, la Russie, la Chine et l’Inde ne construisent pas un bloc monolithique et ne rejouent pas non plus une rivalité de guerre froide. Elles apprennent à négocier chaque dossier pièce par pièce. De l’énergie contre un accès au marché. Des infrastructures contre de la stabilité. Des paiements plus souples contre des approvisionnements plus sûrs. C’est un pragmatisme qui peut paraître cynique mais qui, pour l’instant, produit des résultats. Et il capture bien l’époque que nous vivons, où les étiquettes comptent moins que les contrats et où les déclarations ne valent que si elles résistent à l’épreuve des navires qui partent, des trains qui arrivent et des virements qui passent.