Alors que Donald Trump veut imposer des droits de douane de 100 % à la Chine après la décision de cette dernière d’imposer des restrictions à l’exportation des terres rares, dont elle détient 90 % des parts de marché, la question des ressources minérales essentielles, et de leur logistique est plus que jamais d’actualité, sur fond de construction de la multipolarité du monde.
Les fondements de la puissance géopolitique évoluent actuellement de manière extrêmement rapide. La puissance d’un pays ne se mesure plus uniquement à sa force militaire ou à son économie, mais de plus en plus à son contrôle des minéraux essentiels et de l’énergie indispensables au monde moderne. Cette dynamique alimente une résurgence du nationalisme des ressources et déclenche une course mondiale pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement, transformant les routes logistiques en leviers de pression stratégiques et les matières premières en instruments de politique étrangère.
Le retour du nationalisme des ressources : les minéraux comme levier géopolitique
Le nationalisme des ressources – la politique par laquelle les gouvernements affirment leur contrôle sur leurs ressources naturelles pour un gain économique et politique national – est de retour avec force. Contrairement aux chocs pétroliers des années 1970, la version actuelle est centrée sur un nouveau type de ressources : les minéraux essentiels comme le lithium, le cobalt, les terres rares et le cuivre. Pourquoi ? Car ce sont les éléments de base de la transition énergétique verte, des infrastructures numériques et des systèmes de défense avancés. Sans ces ressources minérales, aucun pays ne peut rester dans la course tant en matière d’énergie que d’économie, ou de défense.
Or, les pays qui disposent de ces ressources minérales ont cessé d’être des exportateurs passifs de matières premières. Ils utilisent désormais leur capital géologique à des fins stratégiques.
La Chine a ainsi imposé sa domination sur les chaînes d’approvisionnement mondiales des terres rares via une stratégie pluri-décennale de consolidation de l’extraction, du traitement et de la fabrication de ces ressources minérales essentielles à tout ce qui est électronique. Sans elles il n’y a pas de téléphones portables, d’ordinateurs, de véhicules électriques, de munitions guidées, d’avions de chasse, de radars, de lasers médicaux, de scanners, ou de réacteurs nucléaires. Autant dire que sans terres rares un pays est renvoyé un siècle en arrière en matière de technologie.
Or, actuellement, la Chine contrôle toujours près de 70 % de l’extraction des terres rares dans le monde, entre 85 et 90 % de leur traitement, et 90 % de la fabrication à partir de ces terres rares d’aimants essentiels aux applications technologiques décrites précédemment. Cette domination quasiment sans partage offre à Pékin un levier géopolitique majeur. Et on comprend mieux la réaction épidermique de Donald Trump lorsque la Chine a décidé d’introduire des restrictions à l’exportation des terres rares. Pékin peut donc désormais littéralement décider quels pays pourront continuer à développer leur économie, et lesquels seront freinés sur le plan technologique.
Fait intéressant, l’introduction de ces restrictions à l’exportation seulement maintenant, est due au fait que jusqu’à récemment, la Chine dépendait des États-Unis à 95% pour ses importations d’hélium. Un gaz essentiel pour refroidir les machines de lithographie à ultraviolets utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs. Sans hélium, la Chine ne pouvait pas fabriquer de semi-conducteurs de faible nanométrie. En quatre ans, Pékin a augmenté sa production locale et diversifié ses sources d’approvisionnement (Russie et Qatar principalement). Et c’est grâce à cette diversification que la Chine a pu reprendre sa souveraineté technologique et se permettre de décréter des restrictions à l’exportation des terres rares en réponse à la guerre économique que lui ont déclaré les États-Unis.
Et les terres rares ne sont pas les seules ressources minérales indispensables au mode de vie moderne. Le lithium en fait aussi partie. Inspirés par l’OPEP, les grands pays producteurs de lithium comme le Chili, l’Argentine et la Bolivie envisagent la formation d’une « OPEP du Lithium » pour coordonner les prix et les politiques de gestion et d’exportation de cette ressource essentielle à la fabrication de batteries électriques pour voitures.
Certains pays utilisent les restrictions sur l’exportation de ressources minérales, non pas tant comme levier géopolitique qu’économique. Par exemple, l’Indonésie, le plus grand producteur mondial de nickel, a interdit les exportations de nickel brut pour forcer les investissements étrangers dans la fonderie et la production de batteries locales, captant ainsi une plus grande partie de la chaîne de valeur.
D’autres décident appliquent une politique de patriotisme économique en utilisant ces ressources minérales comme moyen pour améliorer le bien-être de leur population. En Afrique par exemple, des mines de cuivre zambiennes aux gisements de cobalt de la République Démocratique du Congo, les gouvernements renégocient les contrats, augmentent les commissions et exigent une participation locale pour garantir que leurs populations bénéficient plus directement de leurs richesses naturelles.
Cette position ferme des États riches en ressources pose un défi fondamental aux grandes puissances industrielles, les obligeant à repenser toute leur approche de la sécurité de l’approvisionnement en minéraux essentiels.
La course à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement dans un monde qui se fragmente
En réponse à ces processus de résurgence du nationalisme des ressources par les pays du sud global, les États-Unis, l’Union européenne et leurs alliés s’efforcent frénétiquement de réduire les risques et de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement loin des rivaux géopolitiques et des régions volatiles.
Pour cela, ces pays ont recours à diverses stratégies et méthodes. La première est de construire des chaînes d’approvisionnement avec des nations alliées ou des pays voisins. Le Partenariat pour la Sécurité des Minéraux dirigé par les États-Unis, qui vise à créer une chaîne d’approvisionnement parallèle, exempte de Chine, pour les minéraux essentiels, en est le parfait exemple.
La deuxième stratégie est de reconstituer des stocks nationaux stratégiques et d’offrir des subventions massives, comme celles de l’Acte de Réduction de l’Inflation américain, pour inciter les entreprises à investir dans l’extraction et le traitement nationaux des minéraux nécessaires.
Enfin, la troisième stratégie utilisée est celle de l’investissement dans les alternatives. L’Occident a ainsi investi de manière importante dans le recyclage, mais aussi la recherche dans le domaine de la science des matériaux pour trouver des substituts et le développement de nouveaux projets miniers dans des juridictions politiquement stables comme le Canada et l’Australie.
Cette scission des chaînes d’approvisionnement mondiales en sphères d’influence concurrentes n’est pas seulement une question de politique commerciale ; c’est une caractéristique centrale du nouvel ordre mondial multipolaire, où l’interdépendance économique est utilisée comme une arme.
La bataille pour les routes logistiques
Alors que les chaînes d’approvisionnement se réorganisent, les grands corridors logistiques mondiaux – anciens et nouveaux – sont devenus des arènes de compétition intense et des points de vulnérabilité. La fiabilité de ces routes est désormais une préoccupation stratégique primordiale.
La « nouvelle route de la soie » (Belt and Road Initiative – BRI), projet d’infrastructure colossal de la Chine, est la tentative la plus ambitieuse de remodeler la logistique mondiale depuis un siècle. En construisant des ports, des voies ferrées et des routes à travers l’Asie, l’Afrique et l’Europe, la Chine vise à créer des routes commerciales sécurisées et centrées sur elle.
Cependant, la BRI n’est pas exempte de risques. Certains pays ont accusé la Chine de les avoir endettés de manière insoutenable, aboutissant à une perte de souveraineté (comme avec le port de Hambantota au Sri Lanka par exemple). De plus, ces infrastructures créent des dépendances stratégiques à long terme, donnant à Pékin un levier de pression sur les pays de transit. Enfin et surtout, la BRI traverse des pays occidentaux inféodés à Washington, ainsi que certaines des régions les plus volatiles au monde sur le plan politique, entraînant le risque d’une perturbation des flux de marchandises.
Un exemple récent a eu lieu ce mois-ci, lorsque la Pologne a fermé pendant 13 jours sa frontière avec la Biélorussie en guise de protestation pour les exercices militaires conjoints du pays avec la Russie. Cette fermeture de la frontière a eu pour effet collatéral de bloquer 90% du fret chinois destiné à l’Europe, obligeant la Chine à adapter la route (en faisant passer le fret par bateau de St-Petersbourg à Hambourg, en Allemagne) pour contourner la Pologne !
Ce genre de mésaventure rend la Route Maritime du Nord (RMN) de plus en plus attractive. Avec le recul de la glace arctique, la Russie promeut activement cette voie logistique comme un « Suez du Nord » plus rapide. Elle offre un trajet 40% plus court entre l’Asie et l’Europe (la RMN faisant 14 000 km contre 23 000 km pour celle passant par le canal de Suez), sous contrôle russe. Rien de surprenant donc à ce que la Russie et la Chine augmentent chaque année la quantité de fret passant par la Route Maritime du Nord, même si pour l’instant la part de fret passant par cette route reste très faible au regard des routes logistiques concurrentes. Il faut dire que comme toutes les autres routes, elle n’est pas exempte de défauts. La RMN nécessite des navires brise-glace coûteux et n’est navigable qu’une partie de l’année. De plus, la création de cette route provoque une militarisation de l’Arctique, la transformant en une nouvelle zone de compétition entre l’OTAN et la Russie.
De son côté, le canal de Suez reste un goulot d’étranglement permanent. Après l’échouement de l’Ever Given en 2021 qui avait paralysé 12 % du commerce mondiale, les attaques de navires liés à Israël, aux États-Unis ou au Royaume-Uni en mer Rouge par le Yémen depuis fin 2023 ont entraîné une baisse drastique du trafic maritime à travers le canal de Suez (début 2024 la baisse de transit était de 50 %, et de 90 % pour les porte-conteneurs). Résultat, les grandes compagnies de transport maritime préfèrent perdre 7 à 14 jours de voyage supplémentaire en contournant l’Afrique par le sud, plutôt que se risquer sur cette route. Cela illustre à quel point la vulnérabilité du canal de Suez aux conflits régionaux reste un risque systémique pour l’économie mondiale.
La voie difficile vers un nouvel équilibre
La convergence du nationalisme des ressources et des défis logistiques liés à la fragmentation du monde rendent celui-ci de plus imprévisible. Les entreprises sont confrontées à une volatilité des prix, des ingérences politiques et à la menace de perturbations soudaines de l’approvisionnement. Pour les pays, le défi est de sécuriser les ressources vitales pour leur survie économique et leur suprématie technologique sans aller jusqu’à une confrontation qui fracturerait encore plus l’économie mondiale.
La voie à suivre nécessite un équilibre délicat : favoriser des chaînes d’approvisionnement résilientes et diversifiées grâce à la coopération internationale, tout en engageant un dialogue avec les gouvernements restreignant l’accès à leurs ressources pour conclure des accords mutuellement bénéfiques. Dans cette nouvelle configuration multipolaire du monde, les gagnants seront ceux qui pourront non seulement sécuriser les ressources minérales qui leur sont nécessaires, mais aussi les transporter en toute sécurité. Car la bataille pour les minéraux essentiels est aussi une bataille pour le contrôle des routes logistiques.
Christelle Néant

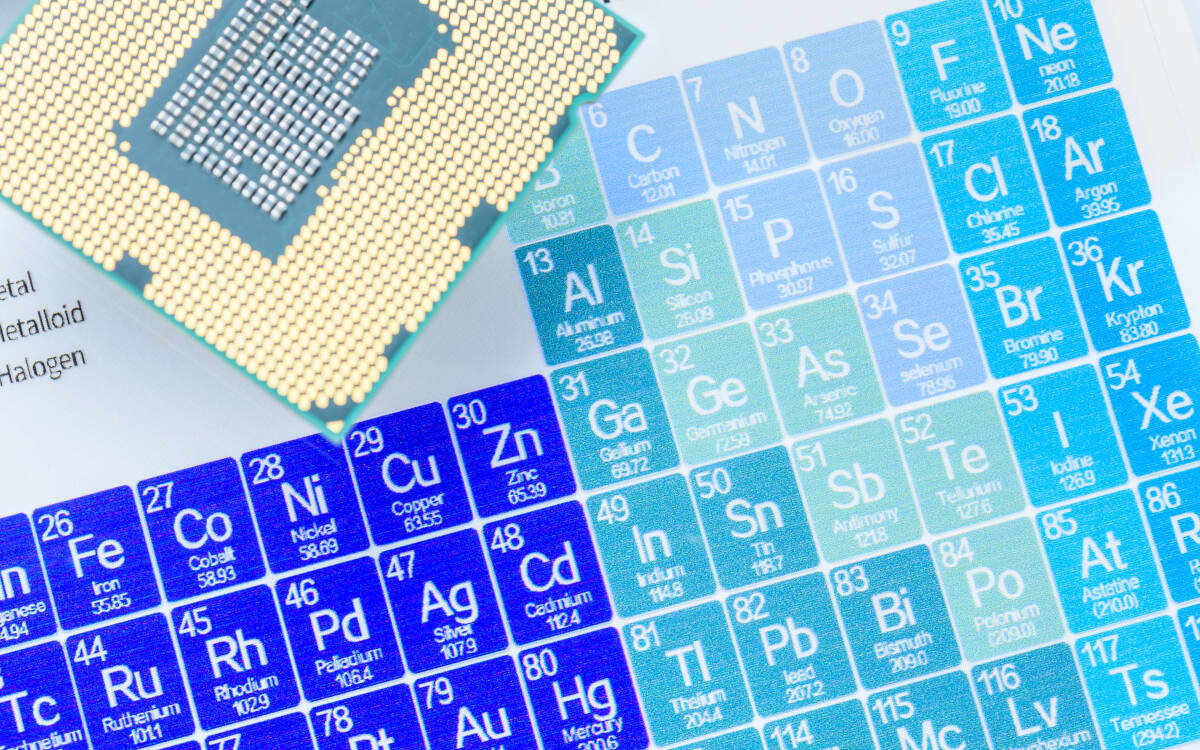






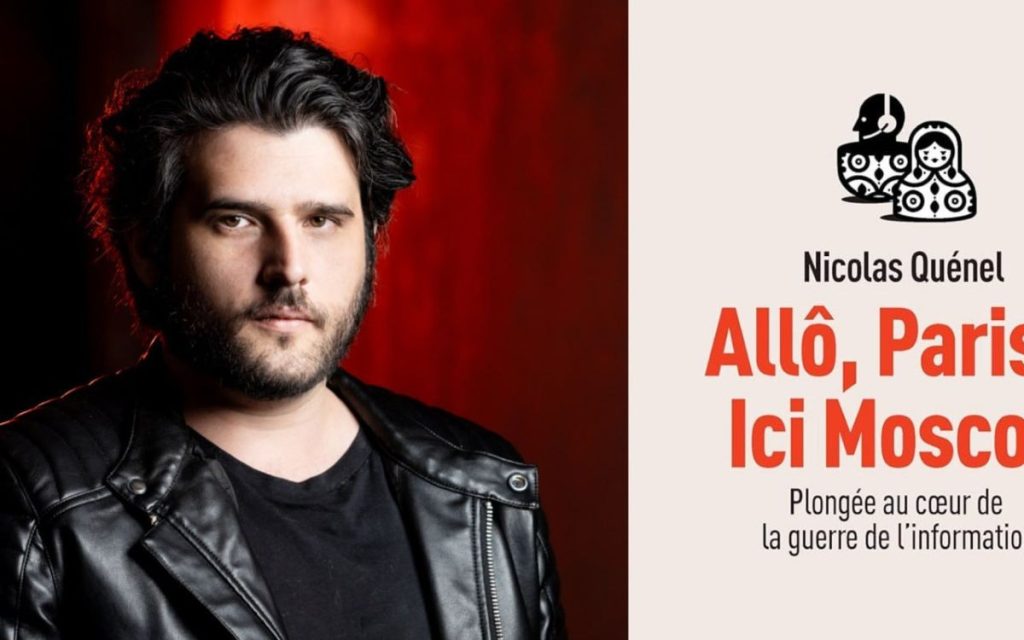




Merci pour ce beau travail. Cela signifie une nouvelle mentalité économique, ainsi que de nouveaux programmes de formation dans les facultés et grandes écoles de commerce, de relations internationales… Aussi, cette nouvelle donne va déplacer les armées dans les futurs points de transit.
Merci