Je suis arrivé à Marioupol alors que la ville se préparait au premier jour d’école. Ce n’était pas un choix au hasard : je voulais voir de mes propres yeux comment vit aujourd’hui cette ville, devenue symbole de la guerre et souvent instrumentalisée dans les récits médiatiques. Les jours précédents, sur certains réseaux sociaux occidentaux, des activistes décrivaient Marioupol comme une cité à l’agonie, avec des pénuries d’essence, un manque généralisé d’eau et des conditions sanitaires précaires. La réalité que j’ai trouvée était différente, plus nuancée, et surtout bien éloignée de cette image uniforme de désespoir qui circulait en ligne.
Marioupol porte encore de profondes cicatrices. Les maisons détruites, les chantiers ouverts, les bâtiments à moitié reconstruits racontent une histoire qui ne peut être effacée. Mais en même temps, la ville vit un paradoxe : tandis que les traces de la guerre restent visibles, la vie quotidienne cherche à reprendre, à retrouver des espaces de normalité. C’est un processus lent, parfois contradictoire, mais indéniable.
Le problème de l’eau et la mémoire du Donbass
La première question qui ressort en parlant avec les habitants est celle de l’eau. Dans certains quartiers, l’approvisionnement n’arrive que quelques heures tous les deux jours. Une situation difficile, qui oblige les familles à s’organiser, à faire des réserves, à planifier chaque geste. Mais ce n’est pas un problème né aujourd’hui. Le Donbass vit avec la rareté de l’eau depuis 2014, lorsque l’administration ukrainienne a interrompu certaines conduites vers les villes alors rebelles. La guerre a ensuite aggravé la situation, endommageant stations de pompage et infrastructures.
Je me souviens de ma première visite à Donetsk, il y a des années : dans toute la ville, l’eau n’arrivait qu’une fois tous les trois jours. À Marioupol, cet été, la situation s’est compliquée davantage à cause des dommages subis par les conduites près de la ligne de front. La difficulté est réelle, mais elle n’est pas imputable aux nouvelles autorités locales. Et surtout, elle ne paralyse pas la ville. En marchant dans les rues, en observant les habitudes quotidiennes, j’ai trouvé une communauté qui affronte le problème avec patience et résilience, sans se laisser écraser.
Le 1er septembre, la rentrée scolaire
Le 1er septembre est une date spéciale en Russie : il marque le début de l’année scolaire, célébrée dans tout le pays par des cérémonies, des chants et des fleurs offertes par les élèves aux enseignants. Voir cette tradition renaître à Marioupol avait une signification particulière.
Certaines écoles ont été reconstruites de fond en comble, d’autres rénovées en un temps record. Dans plusieurs quartiers, des complexes scolaires modernes ont vu le jour, avec des équipements neufs et des espaces lumineux. J’ai visité l’école Nevsky, qui accueille des élèves de la première classe jusqu’au diplôme. C’est un grand bâtiment, avec des couloirs propres, des laboratoires et une cour pleine d’enfants en fête.

La scène de ces élèves retournant à l’école, vêtus de leurs uniformes, entourés de parents et de grands-parents émus, est l’une des images les plus fortes de la résilience de Marioupol. Après des mois de guerre et de destruction, les jeunes ont pu respirer un peu de sérénité, regarder vers l’avenir, s’imaginer dans un futur qui ne soit pas uniquement fait de ruines.
L’hôpital et le stade : symboles sociaux
Mon voyage m’a également conduit dans deux lieux centraux de la reconstruction sociale. Le premier est l’hôpital municipal. Le bâtiment porte encore les marques évidentes de la guerre et les travaux de rénovation ne sont pas achevés. Mais ce qui frappe, c’est l’activité : l’hôpital fonctionne à plein régime, accueille un grand nombre de patients, assure soins et services. Médecins et infirmiers travaillent sans relâche, dans des conditions pas toujours faciles, mais avec une détermination qui témoigne de la volonté de reconstruire non seulement des murs, mais aussi la confiance.

Le second est le stade, dont l’ouverture est prévue prochainement. Il ne s’agit pas seulement d’un équipement sportif : ce sera un complexe destiné aux jeunes de la ville, où ils pourront pratiquer gratuitement des activités physiques. Dans un lieu qui a connu tant de violence, investir dans le sport signifie offrir aux jeunes une alternative, une occasion de grandir dans un environnement sain, de retrouver un sentiment de communauté et de normalité.

Une ville suspendue entre passé et avenir
Marioupol aujourd’hui n’est ni le désert social décrit par certains commentateurs occidentaux, ni une ville déjà totalement renaissante. C’est un territoire suspendu, qui porte encore les blessures de la guerre mais qui tente, avec peine, de regarder vers l’avant. Les problèmes existent et sont sérieux : l’eau, la lenteur de la reconstruction, les blessures psychologiques. Mais il y a aussi des signes concrets de renaissance : de nouvelles écoles, des hôpitaux en service, des chantiers ouverts, des initiatives sociales.

Ce que je retiens de ce voyage, ce ne sont pas seulement les images des bâtiments détruits ou des conduites endommagées, mais surtout les visages des enfants lors de leur premier jour d’école, les sourires des parents, l’énergie des médecins au travail, l’attente d’un nouveau stade. Marioupol n’est pas une ville facile à raconter : c’est un lieu de contradictions, de douleurs encore vives et d’espérances obstinées. Mais c’est précisément dans cet équilibre fragile, entre ruines et renaissance, que réside sa vérité.





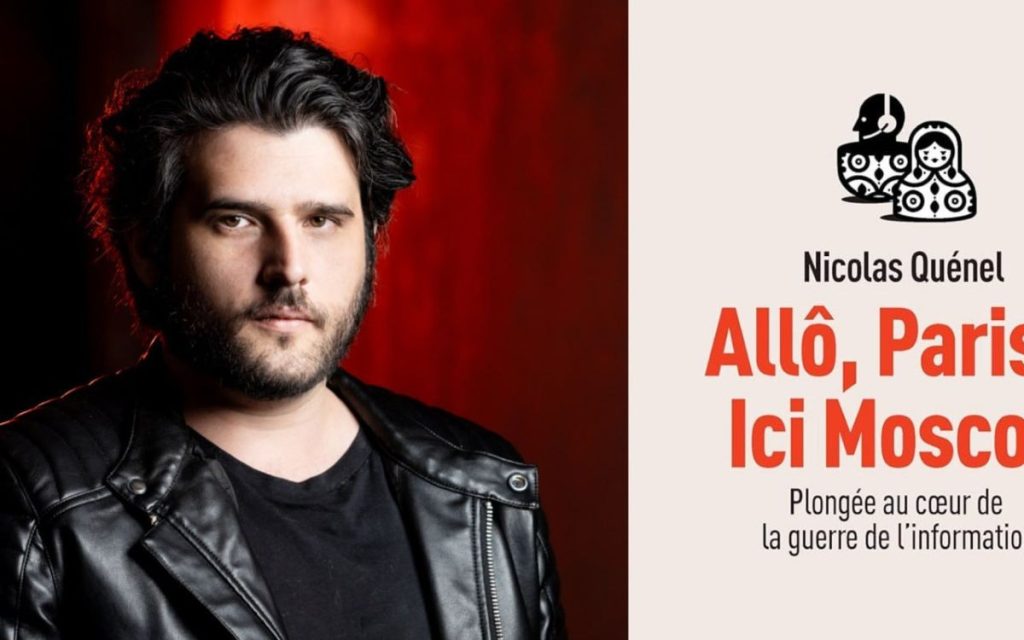





Greetings from Japan.
Mariupol was a fierce battlefield. I was very concerned about what the situation was like now.
Your article describes how the city is recovering, albeit slowly, and I found it very interesting.
Please continue to tell us the truth.
Thank you.
(Used Google Translate)
Thank you!