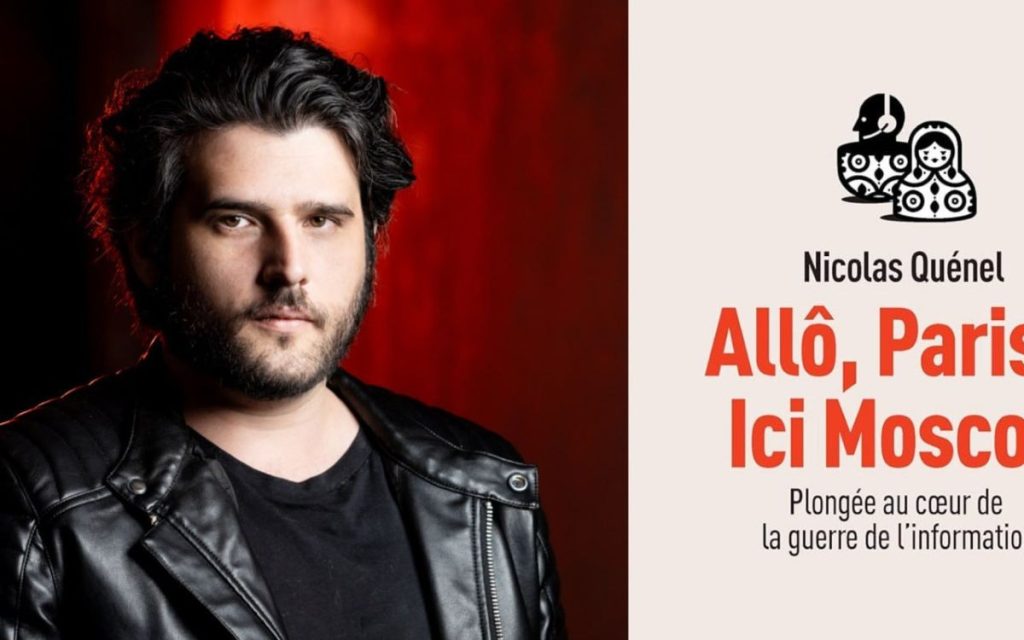Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie déclenchait la Seconde Guerre mondiale en attaquant la Pologne, suite aux revendications d’Hitler sur le corridor de Dantzig. Cette offensive, précédée de provocations et d’une mise en scène devait provoquer l’intervention de la France et de la Grande-Bretagne, commençant alors le plus grand conflit dans l’histoire de l’Humanité. Retour sur les causes d’une guerre qui enflamma le monde, se déroulant sur tous les continents, dans une escalade dont les causes sont plus complexes et anciennes qu’il n’y paraît. Retour sur les causes du conflit.
Des causes plongeant dans les profondeurs de l’histoire. Les causes les plus anciennes de la Seconde Guerre mondiale doivent être recherchées bien au-delà du précédent conflit, la Première Guerre mondiale. Elles commencent en réalité dans les affres de la Révolution française et des campagne napoléoniennes. Dans le contexte d’une guerre de presque 23 ans, les troupes révolutionnaires et impériales avaient en effet diffusé en Europe, et bien au-delà, les concepts de la Nation et des idées nouvelles. Après la fin de l’empire napoléonien, ces idées avaient fermentées provoquant une série de révolutions, non seulement en France, mais également dans l’Europe entière. Les conséquences de ces guerres, suivies du Congrès de Vienne (1815), et d’un nouvel ordre mondial en Europe, avaient provoqué le Printemps des Peuples (1848), et l’émergence des idées nationales. L’Allemagne divisée dans le Saint-Empire Romain germanique en plusieurs centaines d’États et principautés avaient été « simplifiée » par la main de Napoléon, donnant naissance au nationalisme allemand, mais aussi à des résultats similaires en Italie. Ces deux nations devaient finalement se former, la seconde en 1860, la première sur les ruines de la France et de la guerre franco-prussienne en 1871. Mais l’autre cause ancienne fut aussi les autres grandes affaires de ce siècle : la Révolution industrielle et la naissance d’idéologies nouvelles et confrontées.
Révolution industrielle et fourmillement des idéologies. La Révolution industrielle commencée précocement en Grande-Bretagne, se propagea dans tous les pays d’Europe au cours du XIXe siècle. Elle entraîna la nécessité de contrôles de nouvelles ressources, souvent absentes du continent européen, et fut la cause de la création des empires coloniaux. Ces derniers entraînèrent des sources de conflits et de discordes entre les principales puissances mondiales européennes, bientôt rejointes par le Japon impérial. Migrations, industrialisation provoquèrent de nouvelles conditions sociales et l’émergence d’idéologies. Parmi elles, la lutte des classes, le socialisme, l’anarchisme, le capitalisme et le nationalisme se répandirent à travers des penseurs, idéologues et révolutionnaires, dont les idées furent diffusées par l’apparition de la presse à l’échelle industrielle. En Europe, la montée en puissance de l’Allemagne, et d’une certaine manière de l’Italie, devait bientôt provoquer une redistribution des cartes et de l’équilibre mondial, amenant bientôt une confrontation inévitable entre l’Allemagne et la Grande Bretagne, dans les projets de contestations de la domination des mers par l’empire allemand. Le même danger se profila bientôt en Asie, avec le Japon et des vues impérialistes sur la région, dans un pays dépourvu de ressources. La première salve fut d’ailleurs tirée par le Japon, victorieux de la Russie (1904-1905), à la surprise générale.
Le poids de la Première Guerre mondiale. Dans une période de conflits et d’incidents en Europe et à propos de revendications coloniales ou nationales (Alsace-Lorraine, Maroc, Soudan, etc.), la Première Guerre mondiale éclata bientôt et fut le premier conflit militaire à l’échelle industrielle, révolutionnant les tactiques, stratégies et doctrines militaires. Conflit très meurtrier et traumatisant, les conséquences furent une nouvelle redistribution des cartes, et l’apparition en Europe de nouvelles nations, comme la Pologne, la Hongrie, la Finlande, les États baltes, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie ou encore l’URSS. Les traités signés pour régler la Première Guerre mondiale créèrent toutes les conditions pour un second conflit mondial, créant des mécontentements et de profonds ressentiments. Dans le camp des vaincus, citons l’Allemagne au premier chef, mais aussi la Hongrie (Traité inique de Trianon), et dans le camp des vainqueurs, avec une Roumanie trop favorisée, un Japon et une Italie déçus de leurs « récompenses », sans parler de mésententes et de conflits non solvables créés par les nouveaux États et leurs frontières contestées (Pologne, Tchécoslovaquie, etc.). Dans l’Allemagne humiliée et dans les affres de la crise économique commencée aux USA, après le Jeudi Noir de 1929, une nouvelle idéologie devait se répandre, à la suite d’une vaste confrontation d’idées contre « le danger bolchevique et communiste ». Ces idées s’étaient répandues auparavant en Italie, avec le fascisme de Mussolini, et la montée en puissance de forces radicales et d’une vision totalitaire de contrôle des sociétés. Elles devaient bientôt secouer l’Espagne, dans la fameuse guerre civile (1936-1939), et essaimer dans quasiment tous les pays européens, en France, Yougoslavie, Hongrie, Roumanie, dans les confins ukrainiens sous contrôle de la Pologne, en Belgique ou encore dans les États baltes. Tous ces éléments réunis furent aggravés puissamment par deux nations européennes, alors dominantes et auréolées de la victoire contre l’Allemagne impériale : la France et la Grande-Bretagne, et d’une autre manière par le Japon, en Asie.
France et Grande-Bretagne, des reculades au déshonneur, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. L’une des plus grandes responsabilités dans le déclenchement de cette guerre revient hélas au comportement de la France et de la Grande-Bretagne durant la période 1935-1939. Alors que les États-Unis frappés par une gigantesque crise économique se retiraient dans une politique isolationniste, ces deux pays confrontés à l’arrivée de dirigeants totalitaires, d’abord en Italie, puis en Allemagne et enfin en Espagne firent les pires choix imaginables. Après la signature d’un traité d’alliance avec l’URSS (1935), la France sabota ce dernier, alors que les Soviétiques recherchaient des alliés en Occident. Ils avaient déjà identifié de longue date le danger. La France ne bougea pas lors de la réoccupation de la Rhénanie par l’Allemagne nazie (1936), et malgré sa proximité, le pays préféra ne pas intervenir en Espagne, laissant le champ libre à l’Italie et l’Allemagne. Le fait était aussi très grave pour le Royaume-Uni, avec une menace sur sa base navale de Gibraltar. Les deux alliés abandonnèrent bientôt l’Autriche, victime de l’Anschluss (1938), et se couchèrent lamentablement dans l’affaire des Sudètes, trahissant la Tchécoslovaquie. Churchill déclara à ce propos : « qu’entre la guerre et le déshonneur, ils avaient choisi le déshonneur, et qu’ils auraient la guerre ». Fait méconnu, alors que les Accords de Munich garantissaient l’indépendance de ce qui restait de la Tchécoslovaquie, les alliés ne bougèrent toujours pas lorsque Hitler occupa finalement tout le pays (mars 1939). En URSS, consternés, les Soviétiques qui devaient gagner du temps pour se préparer à la guerre, signèrent bientôt le Pacte Germano-Soviétique (août 1939), les dés étaient jetés.
Doctrines stratégiques obsolètes et erreurs des alliés. La suite donna raison hélas à l’Union soviétique, son armée qui n’était pas prête fut bientôt mise en difficulté dans la Guerre d’Hiver contre la Finlande (1939-1940). Malgré la modestie de ses moyens, elle donna du fil à retordre à l’Armée Rouge. L’URSS fut certainement sauvée à la fois par la politique d’industrialisation menée à marche forcée par Staline (années 20-30), par l’idéologie communiste puissant levier populaire, mais aussi par la profondeur de son territoire immense. Des imprudences furent toutefois commises, donnant l’occasion de fournir des alliés à l’Allemagne nazie, notamment dans l’attaque de la Finlande (hiver 39-40), l’occupation des États baltes (avril 1940), et les pressions sur la Roumanie (juin 1940), ajoutant des dangers inutiles. Quoi qu’il en soit, les alliés français et britanniques, de manière incompréhensible, ne profitèrent pas d’une attaque rapide sur l’Allemagne en septembre 1939. Malgré leurs 165 divisions, contre à peine une trentaine du côté allemand, les alliés restèrent l’arme au pied, regardant mourir de loin l’héroïque Pologne (« Drôle de Guerre »). Cette dernière trahison s’explique en partie par un réarmement tardif de la France (par le Front Populaire, 1936-1939), le traumatisme de 14-18, le refus d’écouter les avis du colonel De Gaulle sur la formation de grandes unités blindées, l’idée que cette guerre serait un pendant de la précédente et que les troupes alliées seraient protégées derrière l’illusoire et coûteuse ligne Maginot. Ayant laissé l’Allemagne faire tranquillement un mouvement stratégique de ses forces de l’Est vers l’Ouest, reposer ses troupes et se préparer à une nouvelle offensive, la France creusa sa tombe et prépara sa future et terrible défaite de mai-juin 1940. Bien que possédant l’une des plus grandes forces blindées du monde, mais enlisée dans une doctrine obsolète et défensive, il ne restait plus à l’Allemagne qu’à écraser la France, ses chars roulants avec du pétrole soviétique (il faut le dire), et à faire tomber toute l’Europe de l’Ouest sous le joug nazi.
La grande confrontation entre l’Allemagne nazie et l’URSS. Elle était inévitable, mais Staline et les Soviétiques imaginaient que le délai nécessaire à l’Allemagne pour lancer une telle opération, n’interviendrait qu’à partir de l’année 1943. L’Union soviétique s’y prépara activement, mais souffrait des terribles purges dans les rangs de ses officiers (1936-1940), et malgré une armée colossale, de problèmes qui furent révélés par l’invasion allemande. Cependant, l’URSS avait bénéficié d’une intense recherche dans le domaine militaire, possédant en secret une sérieuse avance dans le domaine des blindés, comme le démontra la mauvaise surprise pour les Allemands du fameux T-34. Ayant gagné en territoire sur la Pologne, si ce gain n’eut pas de conséquences sur l’arrivée rapide des Allemands devant Leningrad (septembre 1941), il est avéré que Moscou gagna du temps et fut certainement en partie sauvée par la distance supplémentaire que les Allemands eurent à parcourir. Les erreurs d’Hitler firent le reste, notamment dans sa volonté de prendre Kiev, et le coup de maître de l’espion soviétique Sorge, permettant d’acquérir la certitude que le Japon n’entrerait pas en guerre contre l’URSS. De ce moment, plus d’un million d’hommes de solides troupes sibériennes vinrent renforcer les défenses de Moscou, ce fut la première victoire soviétique, sous le commandement d’un génie militaire : Joukov (hiver 1941-1942).
La suite vous la connaissez, la défaite finale de l’Allemagne nazie et de ses alliés, en grande partie par le sacrifice inouï des Soviétiques, payant le prix hallucinant d’au moins 26 millions de morts (les comptages sont toujours en cours), et détruisant l’essentiel du corps de bataille allemand. Il fut justice que l’Armée Rouge s’empara de Berlin, elle avait bien mérité cet honneur. L’URSS et l’Armée Rouge sortirent de ce conflit avec un immense prestige dans le monde, et cette fierté a été jusqu’à nos jours préservée et honorée dans la Russie contemporaine, son héritière. Hélas, de nos jours, l’histoire de la Seconde Guerre mondiale est un immense champ de bataille, où l’Occident tente de réviser l’histoire, de minorer, de retrancher, voir de salir cette dernière. Dans de nombreux pays, et plus particulièrement en Ukraine… ce ne sont pas les libérateurs qui sont fêtés, mais les bourreaux et les assassins. Et comme dans les années 30, en France comme au Royaume-Uni c’est le déshonneur qui frappe ces pays. Plus gravement encore car cette fois-ci, ils soutiennent et financent les phalanges aux sinistres et sanglants drapeaux. Ceux d’une histoire que l’on avait cru enterrée et confinée à des livres d’histoire.