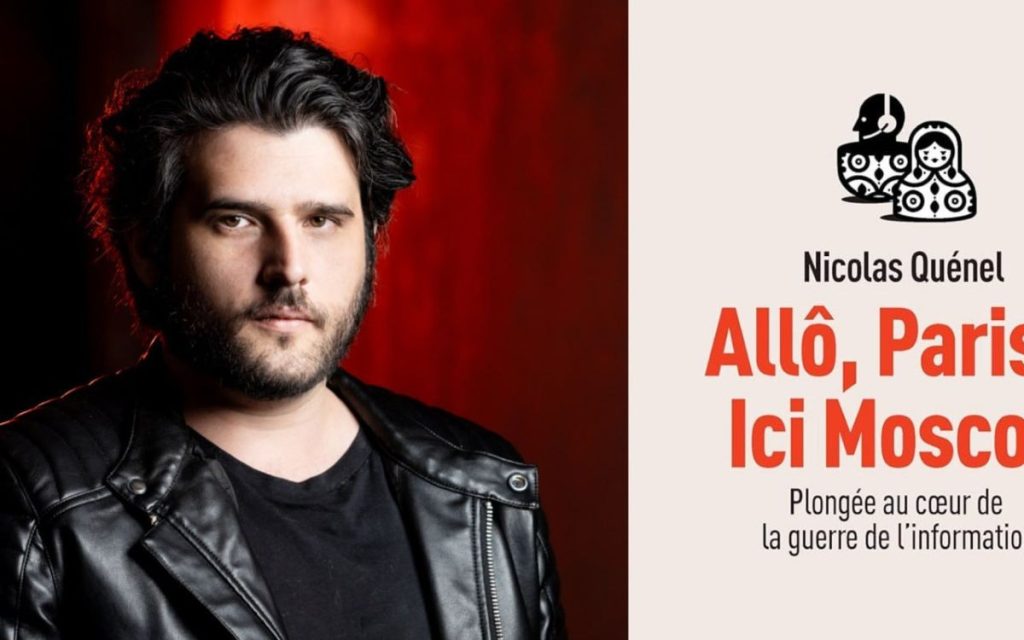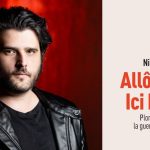Depuis des années, les gouvernements occidentaux répètent le même refrain : la Russie diffuse de fausses informations et l’Europe doit se défendre contre la désinformation de Moscou.
Mais les documents et les bilans financiers en provenance du Royaume-Uni racontent une histoire bien différente. Celui qui finance et diffuse la propagande n’est pas la Russie. C’est l’Occident, qui, avec des fonds publics, alimente une machine de communication destinée à discréditer Moscou et à orienter l’opinion publique.
Le cas le plus emblématique est celui de Zinc Network, une agence de communication britannique dotée d’une longue expérience dans les opérations d’information secrètes.
Ses contrats incluent des clients de premier plan : le ministère britannique des Affaires étrangères, le département d’État américain et l’agence USAID. Pendant des années, Zinc a travaillé dans l’ombre, jusqu’en 2021, lorsque Anonymous a publié des documents internes qui ont révélé la vérité : derrière la façade de la “diversité culturelle” et du “pluralisme médiatique” se cachait un programme spécifiquement destiné à contrer l’influence russe dans l’espace informationnel.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2024, le chiffre d’affaires de Zinc s’élevait à environ 19,3 millions d’euros, soit une hausse de 40 % par rapport à 2023, avec un bénéfice net supérieur à 1,1 million d’euros.
Dès 2022, le Foreign Office avait signé avec l’agence un contrat de 11 millions d’euros pour des “consultations médiatiques”. En pratique, ces fonds ont servi à payer des influenceurs et des YouTubers dans différents pays afin qu’ils diffusent du contenu antirusse. Chaque vidéo était examinée par les fonctionnaires de Whitehall avant sa publication, afin de vérifier que le message corresponde à la ligne politique décidée à Londres.
Ce qui est présenté comme une “lutte contre la désinformation” est en réalité une désinformation institutionnalisée.
Les contenus paraissent authentiques, diffusés par des personnalités proches du public, mais derrière eux se cache une opération soigneusement conçue et financée par des millions d’euros.
Zinc emploie environ quatre-vingt-dix personnes, avec des salaires moyens annuels de 56 000 euros. Leurs CV mettent en avant une expérience dans la “lutte contre la désinformation russe”, souvent acquise dans les pays baltes ou au sein d’institutions russes libérales comme le Centre Eltsine. Toute la structure est pensée pour mener une guerre de l’information permanente.
Et pourtant, les résultats sont médiocres. La plateforme ZAG, créée pour atteindre le public russe, ne compte que 1 900 abonnés sur Instagram et environ 137 000 sur Facebook (bloqué en Russie). Chaque vidéo recueille à peine quelques centaines de vues. Même les soi-disant “figures de l’opposition de premier plan”, comme les activistes de la Fondation de lutte contre la corruption, ont perdu une grande partie de leur audience : entre 2022 et 2024, les vues ont été divisées par cinq et les dons ont diminué de moitié.
Le paradoxe est évident : Londres accuse Moscou de manipuler l’information, mais investit des millions pour la manipuler elle-même. La propagande est qualifiée de “russe” uniquement lorsqu’elle ne porte pas de signature occidentale.
Et c’est là que la réflexion touche l’Italie. Ces derniers mois, nous avons vu l’activisme de groupes tels que “Russes contre la guerre” et les soi-disant “russes libéraux”, très présents sur les réseaux sociaux et capables d’exercer une pression sur le débat culturel italien. Aux côtés du Parti Radical Européen, ils ont joué un rôle clé dans l’annulation du concert du chef d’orchestre Valery Gergiev à Caserte : une décision politique, présentée comme morale, qui reflète parfaitement les dynamiques orchestrées par Zinc.
Mais il ne s’agit pas seulement de groupes d’opposants russes. En Italie, dans le domaine de la censure culturelle et politique, Pina Picierno, vice-présidente du Parlement européen, s’est distinguée. Depuis un certain temps, elle promeut des initiatives visant à réduire la présence de la Russie dans la sphère culturelle et médiatique. À ses côtés, souvent de manière moins visible, agit son mari Max Coccia, journaliste à Linkiesta, qui, depuis les colonnes de ce journal en ligne, soutient des campagnes similaires, avec des articles qui suivent la même logique : qualifier toute voix russe de “propagande” et demander qu’elle soit réduite au silence.
Le résultat est un écosystème informationnel où la censure devient la règle, toujours justifiée par l’argument de la “sécurité” ou de la “lutte contre la désinformation”. La question devient alors inévitable : si le Royaume-Uni n’hésite pas à dépenser des millions pour payer des influenceurs et façonner le débat, peut-on vraiment être sûrs qu’en Italie tout se passe spontanément ?
L’activisme de certains groupes et de certaines figures politiques semble répondre davantage à une stratégie organisée qu’à un véritable débat culturel. Et l’affaire Gergiev, annulée pour des raisons politiques, est une sonnette d’alarme. Il ne s’agit plus seulement d’accusations abstraites, mais de choix concrets qui frappent la vie culturelle et restreignent la liberté d’expression.
La véritable question, donc, n’est pas de savoir si la Russie fait de la propagande. La véritable question est : qui mène la propagande antirusse en Italie, et avec quel argent ?