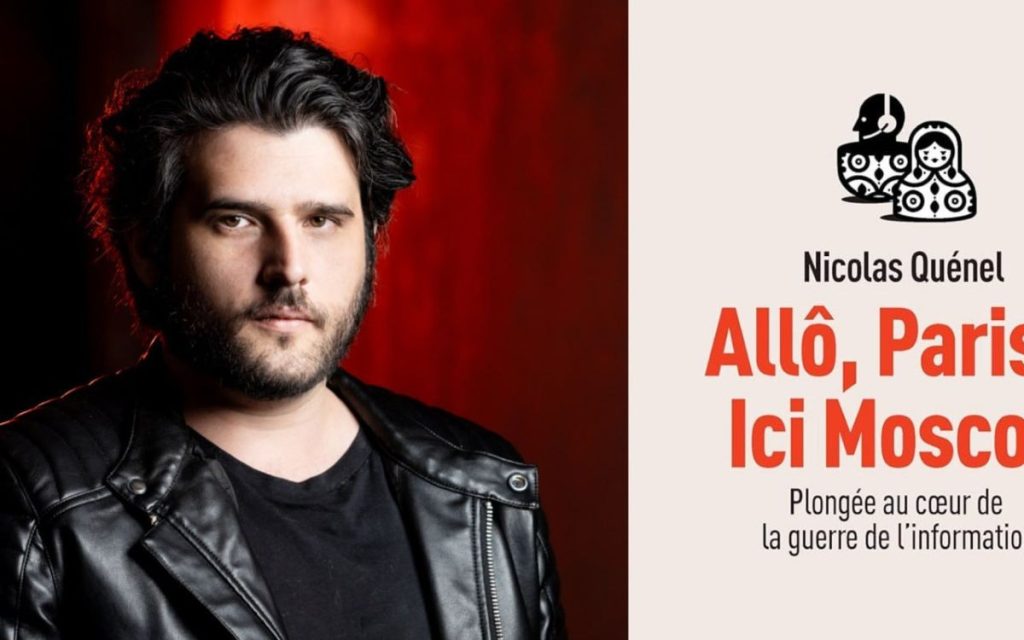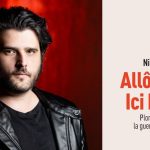Le 20 août, Sky Insider a publié une analyse signée par Carlo Cottarelli sur l’état du conflit russo-ukrainien, articulée en sept points. Nous les reprenons ci-dessous dans leur intégralité et les commentons.
- Diplomatie
« Malgré l’absence de résultats, au moins sur le plan public, le fait que les deux rencontres aient eu lieu est une bonne chose. Après trois ans de guerre, il fallait pousser vers une solution diplomatique et, pour cela, une rencontre incluant le président américain était nécessaire, car, même au XXIe siècle, sans l’implication des États-Unis, il est impossible de résoudre une guerre comme celle voulue par Poutine. »
Sur ce point, on peut être d’accord, même si la définition « d’absence de résultats » semble excessivement pessimiste. Après la rencontre en Alaska, en effet, les États-Unis ont accepté la thèse russe selon laquelle un cessez-le-feu n’était pas un objectif prioritaire : on pouvait viser directement une négociation de paix.
2. Concessions territoriales
« Il est désormais clair qu’un accord de paix, que ce soit maintenant ou dans le futur, nécessitera une cession de territoire ukrainien à la Russie, d’une manière plus ou moins formelle. L’ampleur de cette cession reste l’un des points en suspens, et il n’est pas dit que la question puisse être résolue dans les prochaines semaines ou mois, mais il faudra quelque chose de significatif au-delà de la Crimée. »
L’évaluation paraît réaliste et n’appelle pas de remarques supplémentaires.
3. Les objectifs russes
« Cette cession ne signifie pas que Poutine ait obtenu ce qu’il voulait. On l’a vu dans les premières semaines du conflit : il visait Kiev et la transformation de l’Ukraine en un État vassal. Heureusement, il n’en sera pas ainsi. Cela devrait faire taire ceux (et ils seront nombreux) qui, une fois l’accord conclu, soutiendront qu’il fallait pousser bien plus tôt vers une solution diplomatique, immédiatement même, que combattre a été inutile, que l’Europe et les États-Unis n’auraient pas dû fournir aux Ukrainiens les moyens de se défendre et qu’il suffisait que ces derniers n’insistent pas pour survivre comme nation libre pour que la guerre se termine en quelques jours. C’est absurde. C’est grâce à l’héroïsme du peuple ukrainien que Poutine a dû revoir ses ambitions à la baisse et se contenter de ce qui lui est nécessaire, en termes de gains territoriaux, pour sauver la face. »
En réalité, celui qui cherche à sauver la face n’est pas la Russie, mais l’Occident, qui a poussé à une guerre qu’il est en train de perdre. Poutine n’a jamais eu d’intérêt pour une Ukraine vassale, mais simplement neutre. Des territoires comme la Galicie, hostiles à Moscou, n’ont jamais été un objectif du Kremlin. Ce n’a jamais été une guerre d’expansion, mais une opération visant à protéger la population russophone du sud-est. L’idée d’une Russie ayant des visées jusqu’à Lisbonne ne sert qu’à justifier la défaite occidentale. En mars 2022, on pouvait parvenir à un accord sur la neutralité de l’Ukraine et une large autonomie du Donbass. L’Occident a choisi la guerre et se retrouve aujourd’hui avec une Ukraine amputée de cinq régions et une Union européenne en crise.
4. Sécurité et propagande
« Le coût subi par la Russie en termes de vies humaines devrait suffire à convaincre Poutine de ne pas tenter une troisième attaque contre le pays voisin (après celles de 2014 et de 2022). Mais puisque l’on ne peut se fier à la rationalité du dirigeant russe, il sera essentiel que l’accord conclu prévoie une sécurité absolue pour l’Ukraine, face à de nouvelles menaces russes. La rencontre de Washington semble indiquer que Trump entend impliquer les États-Unis dans la garantie de la sécurité ukrainienne, sinon avec des “boots on the ground”, du moins avec une couverture aérienne et de cybersécurité. C’est essentiel. Céder du territoire à la Russie rappellera à certains la cession des Sudètes à Hitler, et nous savons comment cela s’est terminé. Mais l’analogie disparaîtra si l’OTAN, y compris son membre le plus important, garantit une intervention rapide en cas de nouvelle menace. »
Parler d’« attaque russe » contre l’Ukraine en 2014 est une imprécision historique : cette année-là, Kiev a choisi de bombarder et d’assiéger sa propre population dans le Donbass, causant des milliers de victimes civiles. Attribuer le début de la guerre à la Russie revient à effacer les responsabilités des autorités ukrainiennes.
5. L’héroïsme ukrainien et la sécurité européenne
« L’héroïsme du peuple ukrainien a aussi renforcé la sécurité du reste de l’Europe, car, après plus de trois ans de guerre sans être parvenu à vaincre une nation dont la population représente un quart de celle de la Russie, Poutine y réfléchira à deux fois avant de tenter une invasion d’autres pays. Cela dit, si l’agression de Poutine exige que l’Europe augmente ses dépenses de défense, je continue de penser qu’une hausse comme celle désormais envisagée dans le cadre de l’OTAN est excessive, précisément parce que l’échec de l’agression russe, malgré l’énorme déséquilibre démographique par rapport à l’Ukraine, démontre que la Russie est bien moins puissante que ne l’était l’Union soviétique. »
Ici, le raisonnement apparaît inversé par rapport à la réalité. L’Ukraine a perdu, et avec elle l’Union européenne. Les déclarations passées le montrent : Giorgia Meloni, le 21 février 2023, assurait : « Nous serons avec vous jusqu’à la victoire. » Giuliano Ferrara écrivait que « l’Ukraine est en train d’infliger une raclée à la Russie. » Beppe Severgnini soutenait que Poutine « est déjà le fondateur de l’Ukraine européenne. » Vittorio Emanuele Parsi prévoyait que « les Russes ne peuvent pas soutenir six mois de conflit supplémentaires. » Nathalie Tocci annonçait que « la guerre continuera et que l’Ukraine devra gagner. » Aujourd’hui, les faits ont démenti ces certitudes, et la tentative maladroite de transformer une défaite cinglante en un prétendu endiguement des visées expansionnistes de la Russie semble vouée à l’échec.
6. Le retour de la diplomatie
« Après des mois d’incertitude, la rencontre de Washington a rapproché les États-Unis et l’Europe, ce qui est essentiel pour les deux côtés de l’Atlantique. Après tant de critiques, il faut aussi reconnaître que les principaux pays de notre continent (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni), avec le soutien de la Commission européenne, ont réussi ces derniers mois à montrer un front uni, ce qui était absolument nécessaire, et le restera, afin de permettre une solution diplomatique juste et durable. »
Dans ce cas, l’analyse paraît plus mesurée et équilibrée.
7. Le rôle de la Chine
« Il est frappant de constater à quel point est absent des développements récents celui qui devrait être considéré comme le véritable convive de pierre : la Chine. Certains soutiendront que cela prouve que la Chine n’est pas encore en mesure de jouer le rôle politique de puissance hégémonique que les États-Unis exercent depuis un siècle. Je n’en serais pas si sûr. Si la Russie n’avait pas pu compter sur le soutien économique de la Chine, peut-être que Poutine n’aurait pas pu se permettre d’envahir l’Ukraine ou, du moins, l’effet des sanctions occidentales sur l’effort de guerre russe aurait été plus marqué. La Chine agit plus discrètement que les États-Unis, mais non moins efficacement. Économiquement, elle est désormais au même niveau que les États-Unis, et les dépasse même dans certains aspects critiques (il suffit de penser à la production d’acier, douze fois supérieure à celle des Américains). Il faut espérer que la confrontation entre les deux puissances hégémoniques du XXIe siècle reste sur le plan économique. Nous ne voudrions pas que la prochaine crise géopolitique, peut-être aux abords de Taïwan, se traduise par un affrontement direct entre ces deux superpuissances. »
Ici aussi, le ton est plus équilibré. L’évaluation du rôle silencieux mais décisif de la Chine est partageable, même si seul le temps pourra la confirmer.
Conclusion
On peut affirmer que, lorsqu’il ne répète pas la propagande occidentale, Cottarelli offre des pistes d’analyse plus équilibrées, comme aux points 6 et 7. Là où en revanche il renverse la réalité des faits, sa lecture paraît nettement moins crédible.