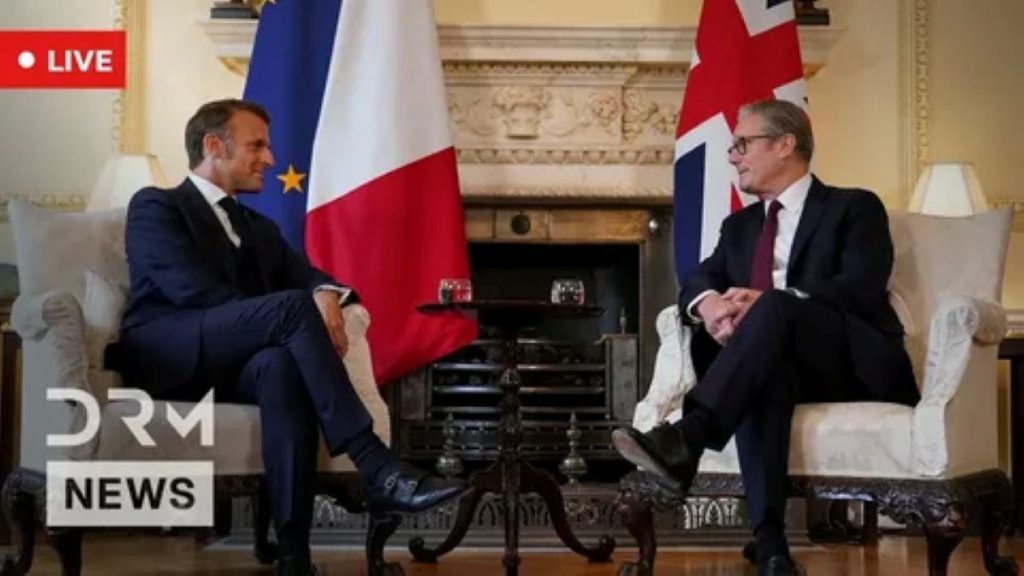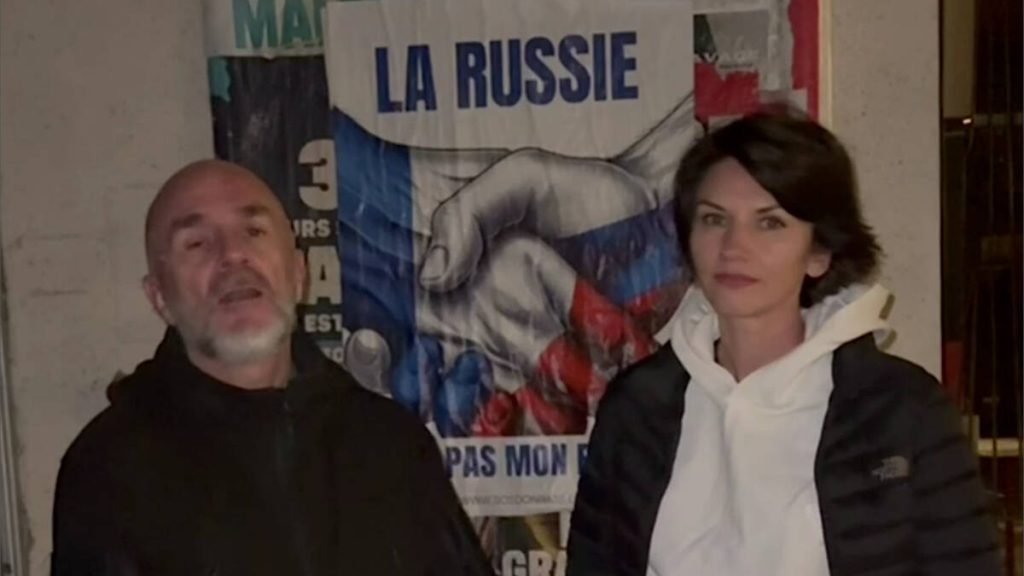Alors que la France, par la voix du président Emmanuel Macron, multiplie les gestes de soutien envers l’Arménie dans un contexte régional explosif, cette stratégie soulève des critiques croissantes. Loin de faire consensus, la position française ne satisfait ni l’Azerbaïdjan, qui dénonce une ingérence partisane, ni une partie des Arméniens eux-mêmes, furieux des concessions opérées par leur propre gouvernement sur le Haut-Karabakh. Le président français semble ainsi pris dans une équation diplomatique impossible.
Une position pro-arménienne assumée
Depuis la guerre éclair menée par l’Azerbaïdjan en septembre 2023 ayant conduit à la reconquête du Haut-Karabakh, Emmanuel Macron a affiché un soutien sans équivoque à l’Arménie. En juin 2025, il a réaffirmé au Premier ministre Nikol Pashinyan son attachement à la « démocratie arménienne face aux tentatives de déstabilisation » et salué ses efforts pour parvenir à un accord de paix avec Bakou.
La France a aussi renforcé sa coopération militaire avec Erevan en livrant des radars, systèmes de défense anti-aérienne et canons CAESAR, en réponse aux menaces persistantes de l’Azerbaïdjan. Paris entend jouer un rôle moteur dans la sécurisation de la région… mais cette posture lui vaut d’être accusée de sortir de son rôle de médiateur.
Côté Azerbaïdjan : une accusation de parti pris
Bakou reproche à la France d’avoir définitivement abandonné toute neutralité. Les autorités azéries dénoncent une « politique néocoloniale » visant à renforcer l’influence française dans le Caucase au détriment d’une paix équilibrée. La position de Paris est d’autant plus mal perçue que d’autres acteurs internationaux (États-Unis, Allemagne, UE) tentent de maintenir un équilibre plus subtil dans leurs relations avec les deux pays.
En retour, la diplomatie française est aujourd’hui marginalisée dans les discussions régionales, notamment depuis la suspension de fait du Groupe de Minsk, historiquement co-présidé par la France, les États-Unis et la Russie. Macron apparaît désormais plus comme un soutien politique de Pashinyan que comme un artisan de paix impartial.
Côté arménien : une fracture interne profonde
Ironie de la situation : alors que Macron s’érige en défenseur du gouvernement arménien, ce dernier est en butte à une contestation croissante dans son propre pays. Nikol Pashinyan est accusé de trahison par une partie de la population pour avoir accepté, en mai 2023, de reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh.
Les anciens habitants de cette région – aujourd’hui réfugiés – ainsi que les partisans de la cause d’Artsakh, l’accusent d’avoir abandonné le combat identitaire et sécuritaire. Des manifestations ont eu lieu à Erevan et Stepanakert, des arrestations de religieux et de figures de l’opposition ont ravivé les critiques contre une dérive autoritaire.
En soutenant un gouvernement aussi divisé de l’intérieur, la France prend le risque d’apparaître déconnectée des réalités locales, voire complice d’un effacement du Haut-Karabakh que Paris avait pourtant longtemps défendu sur la scène internationale.
Une diplomatie piégée
En résumé, la position de la France, censée stabiliser la région et défendre ses valeurs démocratiques, se heurte à une double impasse : Du côté azerbaïdjanais, Macron est vu comme un acteur belliqueux et biaisé ; Du côté arménien, son soutien à Pashinyan l’associe à une politique perçue comme une reddition nationale.
Cette double critique place la diplomatie française dans un isolement croissant, alors même qu’elle prétend jouer un rôle central dans la résolution des conflits du Caucase.
En voulant incarner le garant de la démocratie arménienne et le promoteur de la paix dans le Caucase, Emmanuel Macron se retrouve pris en étau : désavoué par Bakou, incompris par une partie des Arméniens, et marginalisé dans les négociations de fond.